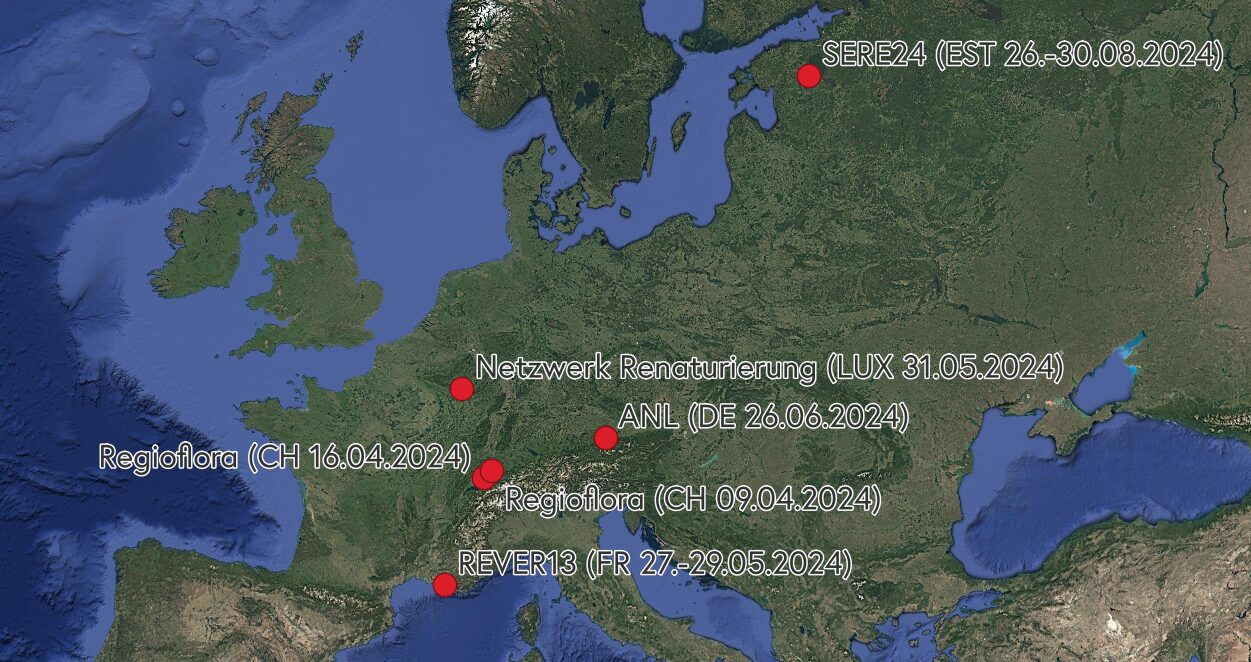Les principaux conseils pour réussir des ensemencements riches en espèces !
Les semences autochtones sont trop précieuses pour ne pas être utilisées de manière optimale. En effet, même les meilleures semences ne donnent de bons résultats que si elles sont semées et entretenues/gérées dans les règles de l’art.
Choix du site
Il est possible de créer avec succès des prairies stables et riches en espèces sur presque tous les sites (sol, exposition, altitude, etc.), à condition de semer les bonnes espèces dans les règles de l’art et d’adapter l’entretien ultérieur à la population végétale.
Les difficultés pour le réensemencement des prairies riches en espèces :
- Zones ombragées et/ou de petite taille. Dans ces conditions, les limaces peuvent éliminer complètement la plupart des espèces semées dès le stade de la plantule. Ce qui reste, ce sont des peuplements monotones, pauvres en espèces, souvent constitués uniquement d’herbes et de plantain. Conseil : les surfaces à ensemencer entourées de prairies ou de bois existants ne doivent pas mesurer moins de 6 mètres de largeur.
- Sols marécageux drainés avec un bilan hydrique équilibré. Dans ces conditions, la décomposition de la tourbe libère tellement de nutriments qu’un petit nombre d’espèces deviennent dominantes et évincent la plupart des espèces ensemencées. Dans cette condition (rare), les ensemencements riches en espèces ne sont généralement pas rentables.
- Les surfaces qui sont ou ont été envahies par des chardons des champs, des rumex ou des néophytes envahissantes (par ex. solidage, vergerette annuelle) ne peuvent généralement être « assainies » après un ensemencement qu’au prix d’efforts considérables. Pratiquement toutes les autres espèces (en particulier les annuelles !), communément appelées « mauvaises herbes », ne posent aucun problème pour le développement souhaité de la prairie si elle est entretenue correctement !
En règle générale, les sols pauvres permettent le développement d’un plus grand nombre d’espèces végétales et animales, ainsi que d’espèces plus rares, que les sols riches en nutriments. En revanche, sur les sols très pauvres, la diversité des espèces est à nouveau plus faible et l’ensemencement s’avère souvent difficile, en particulier sur les sols bruts graveleux avec peu ou pas de particules fines (sable, limon, argile). Les situations exposées au sud ou ombragées aggravent encore la situation. D’un autre côté, les sols avec un apport moyen en nutriments et en eau produisent généralement des peuplements plus riches en fleurs que les sols pauvres. Mais il est également possible d’établir avec succès des prairies riches en fleurs et en espèces (appelées « prairies à fromental ») sur des sols auparavant exploités de manière intensive et riches en nutriments.
Recommandation : recouvrir les talus de terre brute graveleuse de 2-3 cm de terre végétale pauvre en nutriments (humus) ou mélanger au gravier une proportion de 20-30% de terre végétale pauvre en nutriments et exempte de mauvaises herbes. Les talus ainsi préparés offrent des conditions optimales pour le développement d’une végétation stable et riche en espèces, avec une protection élevée contre l’érosion.
Préparation du lit de semence
Un lit de semence exempt de végétation, bien rappuyé et finement émietté est l’une des conditions les plus importantes pour un semis réussi.
Le sol peut être débarrassé de la végétation par un labour ou plusieurs hersages, ou dans certains cas par un recouvrement avec un bâche horticole noire ; les pulvérisations d’herbicides ne sont pas recommandées. Les ensemencements (sursemis) dans des prairies existantes sans supprimer l’ancienne prairie n’aboutissent jamais !
Un sol « bien rappuyé » signifie que le dernier travail du sol en profondeur (labour, hersage, apport d’une couche de terre) remonte à au moins trois semaines avant le semis. La raison : si le sol est trop meuble lors du semis, il n’y a pas de cohésion du sol et les jeunes plantules risquent de ne pas pouvoir s’enraciner correctement ; de plus, l’apport d’eau du sous-sol est insuffisant.
Juste avant le semis, le sol ne doit être hersé ou fraisé que très superficiellement (à environ 3 cm de profondeur) si nécessaire (« cure de désherbage »).
Date de semis
Dans la mesure du possible, les semis doivent être effectués en avril ou en mai*. Les semis plus tardifs peuvent être affectés par des périodes de sécheresse et de chaleur (surtout les graminées)*. Pour les semis d’automne, les pertes pendant l’hiver sont également généralement considérables (en particulier pour les herbacées/fleurs de prairie). Si les semis ne peuvent pas être effectués en avril ou en mai, par exemple pour des raisons de protection contre l’érosion, l’utilisation de cultures intermédiaires et de cultures de couverture s’impose. Il est recommandé de demander conseil à des spécialistes.
—
* Ne s’applique évidemment pas aux transferts de fauche, qui doivent être effectués lorsque les surfaces donneuses sont à maturité optimale, c’est-à-dire généralement en juin ou juillet.
—
Semis
Selon la situation et l’équipement, la quantité de semences indiquée est appliquée en surface à la main ou à l’aide de machines appropriées (hydroseeder, semoir, épandeur d’engrais, etc.). N’enfouissez pas les semences dans le sol ! Pour les petites surfaces, il est recommandé de semer à la main, en croisant les trajectoires de semis pour assurer un semis régulier. Sur les sols meubles (par exemple les terres agricoles), le roulage doit être effectué immédiatement après le semis. Les rouleaux articulés (par exemple les rouleaux Cambridge) conviennent. Les petites surfaces peuvent également être « tapotées » ou « tassées ».
Entretien du semis l’année de l’ensemencement
Presque toutes les plantes des prairies riches en espèces ne germent que quelques semaines après l’ensemencement et ne se développent que très lentement par la suite. En revanche, les « mauvaises herbes » ne se laissent généralement pas faire : surtout sur les sols humifères, les plantes annuelles issues de la banque de semences du sol peuvent prendre le dessus en peu de temps.
Il s’agit alors de garder son calme, car cela est tout à fait normal et n’affecte en rien le développement ultérieur de la prairie. Il est toutefois important de ne pas attendre trop longtemps avant de procéder à la taille dite « d’entretien », afin que les plantules des espèces semées ne soient pas noyées sous une épaisse couverture végétale.
Règle générale : après l’ensemencement, dès que le sol est tellement recouvert de « mauvaises herbes » par endroits qu’il n’est plus visible, il convient de procéder à une taille d’entretien :
- Tondre haut (5-10 cm).
- Les déchets de tonte doivent être évacués.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une deuxième taille d’entretien l’année de l’ensemencement si les espèces annuelles se développent à nouveau rapidement. Il est également possible qu’aucune taille d’entretien ne soit nécessaire, à condition que peu de « mauvaises herbes » se développent et qu’il y ait toujours suffisamment de lumière sur le sol.
Il est important de jeter à nouveau un coup d’œil à la végétation en septembre : La végétation ne doit pas dépasser la hauteur du poing pour l’hiver, afin que les jeunes plants ne soient pas recouverts d’une couche de litière.
Si des rumex ou des néophytes envahissantes se développent, il est recommandé de les arracher dès l’année d’ensemencement. Pour toutes les autres « mauvaises herbes », le sarclage ne sert à rien, au contraire, le dommage serait plus grand que le bénéfice, la taille d’entretien suffit amplement.
N’oubliez pas que l’année de l’ensemencement, on ne voit encore pratiquement rien des espèces semées et qu’il est difficile de juger si un ensemencement est réussi ou non.
Gestion/entretien les années suivantes
Ce n’est que l’année suivant l’ensemencement que l’on peut voir si les graines se développent bien et que l’aspect de la future prairie commence à se dessiner peu à peu. Cependant, selon l’emplacement et les espèces semées, il faut généralement une année supplémentaire, voire plus, pour que toutes les plantes s’établissent correctement et qu’une population végétale stable se développe.
Comme pour un bon vin, la patience est donc de mise lors du réensemencement de prairies riches en espèces ! Les bonnes choses prennent du temps.
Mais dès maintenant, dans l’année qui suit l’ensemencement, il est possible de passer à un entretien/une utilisation régulière avec une ou deux tontes annuelles. La fauche doit impérativement être adaptée au peuplement végétal visé et donc aux espèces ensemencées. Il est difficile de faire des recommandations générales dans ce domaine. On peut toutefois affirmer ce qui suit, de manière générale :
- Plus de deux coupes de fauche ne sont en aucun cas nécessaires pour les prairies non fertilisées : elles nuisent à la biodiversité et entrainent, outre des efforts, des coûts et une consommation de ressources inutiles.
- En règle générale, la fauche doit être effectuée environ 1 à 2 semaines après la floraison principale de la prairie, afin de permettre le semis. Dans de nombreux cas, la première date de coupe optimale se situe en juin ou dans la première quinzaine de juillet, dans les zones de basse altitude.
- Lorsqu’il n’y a pas d’exigences concernant la première date de fauche (comme pour les surfaces écologiques agricoles), une variation annuelle du régime de fauche est favorable à la biodiversité (fauche tantôt plutôt précoce, tantôt plutôt tardive, etc.)
- Lors de la fauche, toujours laisser de petits restes pour que les animaux puissent se réfugier dans les structures restantes et que les espèces à floraison tardive puissent encore se développer jusqu’à la maturité de leurs graines. Il est préférable de laisser 5 à 10 % de la surface non fauchée sous forme de bandes de refuge à chaque coupe, à chaque fois à un endroit différent. Il est également recommandé de procéder à une fauche échelonnée (dates de fauche différentes sur de petites surfaces) lorsque cela est possible en termes d’effort.
- Si possible, laisser du foin au sol après la fauche, c’est-à-dire faire sécher l’herbe sur place pendant 2 à 3 jours sans précipitations, afin que les graines des plantes puissent mûrir et tomber.
- L’herbe coupée doit être évacuée dans tous les cas. En règle générale, le paillage réduit rapidement la diversité des espèces végétales.
- Si des rumex ou des néophytes envahissantes telles que les solidages nord-américains ou la vergerette annuelle se développent, ils doivent être désherbées régulièrement et, si possible, dès le début. Plus vous commencez tôt et de manière conséquente, plus vous économiserez de travail à long terme.
Littérature complémentaire
- Leitfaden zur Renaturierung von artenreichem Grünland. SALVERE 2012. >>pdf
- Blumenreiche Heuwiesen aus Ackerland und Intensiv-Wiesen. Eine Anleitung zur Renaturierung in der landwirtschaftlichen Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 32/6 (2000), 161-171. >>pdf
- Der Weg zu artenreichen Wiesen. Agridea-Merkblatt, 2010.
- Renaturierung artenreicher Wiesen auf nährstoffreichen Böden. Ein Beitrag zur Optimierung der ökologischen Aufwertung der Kulturlandschaft und zum Verständnis mesischer Wiesen-Ökosysteme. Dissertationes Botanicae Band 303, Stuttgart 1999. >> Version en ligne
- Altgrasstreifen fördern Heuschrecken in Ökowiesen – Eine Möglichkeit zur Strukturverbesserung im Mähgrünland. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (7), 2010, 212-217. >>pdf
Pour plus d’informations, voir la documentation technique.